CHAMFORT : LE SENS DU PARADOXE
François RASTIER
CNRS
(Paru dans Le paradoxe
en linguistique et en littérature,
textes recueillis par Ronald Landheer et Paul J. Smith,
Genève : Droz, 1996, p. 117-147)
SOMMAIRE :
1. Structures lexicales
1.1. Les classes scalaires
1.2. Les types de parcours paradoxaux
1.3. Les zones de valorisation
1.4. Les paradoxes doubles et les afférences par homologation
1.5. Vers une restructuration du lexique ?
2. Les composantes sémantiques
2.1. Thématique et topique
2.2. L’énonciation représentée et les narrateurs
2.3. La dialectique et l’histoire de l’humanité
2.4. Spécificité de Chamfort et style paradoxal
3. Directions de recherche
Résumé : Le paradoxe se définit d’abord
comme une forme sémantique, liée aux propriétés de certaines classes lexicales.
Cette forme permet trois sortes de parcours interprétatifs. Leur effet dépend
des zones valuées qu’ils relient ; et diverses figures rhétoriques peuvent
articuler des paradoxes.
Le paradoxe structure
les diverses composantes du système sémantique de Chamfort, et y définit même
le sens de l’histoire.
La significativité
propre du paradoxe a contraint la réception de Chamfort, et ouvre une réflexion
sur son utilisation dans d’autres sortes de discours, théologique par exemple.
Abstract: Paradox is first defined as a semantic form related
to the properties of some lexical classes. This form allows three kinds of
interpretative paths. Their meaning depends on the zones of valuation that they
connect together. Various rhetorical figures can express paradoxes.
Paradox structures the components of Chamfort’s
semantic system, and defines there even the general line of History.
The proper significance of the paradoxical form
directed the reception of Chamfort, and initiates further reflection on its use
in other kinds of discourse, the theological one for example.
|
Tout ce qui est à la fois bon et grand est paradoxe. |
|
Friedrich Schlegel, Fragments critiques, 47. |
|
Le penseur sans paradoxe est, comme l’amant sans passion, une belle médiocrité. |
|
Kierkegaard, Miettes philosophiques, t. VII. |
Chamfort eut l’honneur de s’attirer les insultes posthumes de Chateaubriand et de Sainte-Beuve ; il a conservé la faveur privée de nos grands moralistes tragiques, Giono, Camus, Cioran. Mais sa fortune académique — si c’est une fortune d’attirer les scoliastes — aura été jusqu’ici assez médiocre — ce qui allège à propos notre bibliographie. En France, où les critiques ne se soucient guère de distinguer leur estime de leur goût, la droite lui reproche encore son jacobinisme et la gauche ne lui pardonne pas d’avoir été poussé au suicide par la Terreur. Geste isolé après les festivités du bicentenaire de la Révolution, l’étude qu’on va lire commémore à sa manière le bicentenaire de sa mort.
Les idées reçues sur Chamfort abondent en clichés paradoxaux : ce jacobin mondain, ce misanthrope répandu écrivait sous pseudonyme mais ignorait peut-être son véritable nom. Roturier bien reçu, courtisan atrabilaire, il reste le seul académicien qui ait milité pour la suppression de l’Académie. Il fut illustre pour des œuvres oubliées, mais reste connu pour un recueil posthume dont nous restent les pages que la police politique a omis de détruire.
En faisant de Chamfort un paradoxe vivant, la critique suit ses éducateurs, comme Madame de Craon, qui voulait passer pour sa première maîtresse, et certifiait : « Vous ne le croyez qu’un Adonis, et c’est un Hercule ! ». Prenons plutôt pour hypothèse que le paradoxe est une forme primordiale de son œuvre, et que le beuvisme latent de la critique reverse à son caractère ce que nous entendons décrire dans ses écrits. Ce n’est donc pas son talent épigrammatique qui nous retiendra, <p. 118> mais simplement la sémantique du paradoxe dans Produits de la civilisation perfectionnée [1]. Ainsi, dans le titre de cette étude, sens ne désigne pas une disposition personnelle, mais bien l’objet de la sémantique.
1.1. Les classes scalaires ![]()
Bien que le concept même de paradoxe soit issu de la logique [2], nous aborderons la question par le biais de la sémantique lexicale. Nous souhaitons étudier comment les effets de contexte remanient les structures lexicales jugées ordinaires et les axiologies qui les sous-tendent. Ces structures paraissent codifiées par la langue, ou le sont du moins par des normes sociales invétérées. Nous formulons l’hypothèse que leur remaniement résulte de normes idiolectales qui peuvent servir à caractériser le style de Chamfort [3].
Limitons-nous dans un premier temps à l’interaction entre deux composantes sémantiques : la thématique dont relève la théorie des classes lexicales et la dialogique dont relève la théorie des évaluations.
Les classes lexicales minimales sont les taxèmes. Certains taxèmes ont une structure scalaire : ex. un peu, beaucoup, passionnément ou bleu, saignant, à point, bien cuit. Ces structures thématiques simples sont souvent redoublées par des structures évaluatives (qui relèvent de la dialogique), car elles introduisent des modalités, généralement thymiques, que nous rassemblerons sous le terme générique d’évaluations. Par exemple, dans le taxème des degrés de température ou dans celui des tailles on relève deux seuils d’acceptabilité qui les divisent en zones évaluatives <p. 119> :
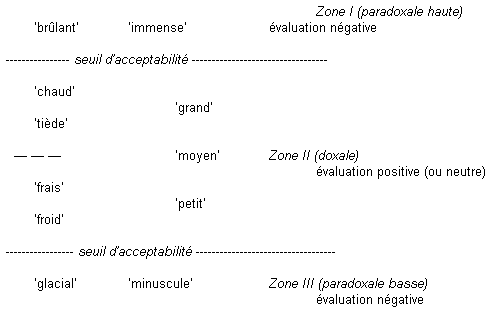
Figure1 : Les zones doxale et paradoxales
Cette représentation s’inspire des descriptions de la sémantique structurale (Pottier, Coseriu). Elle doit être nuancée, car elle est trop objectiviste. D’une part, la position du seuil d'acceptabilité dépend étroitement des contextes et de la pratique en cours. Par exemple, pour la température d'un bain, le seuil inférieur est situé entre ‘frais’ et ‘tiède’. Pour celle d'une bière, il sépare ‘frais’ de ‘froid’. Si bien que ‘tiède’ sera inacceptable par excès pour une bière et à peine acceptable pour un bain. Aussi faut-il admettre l’existence de taxèmes ad hoc, comme celui des degrés de température d’un bain (qui comporte sur mon thermomètre la mention enfant ), et celui des degrés de température d’une bière (qui ne comprend pas le degré ‘brûlant’, non attesté du moins à ma connaissance). Le taxème des degrés de température est déjà une reconstruction des linguistes, qui généralement préfèrent annuler les effets de contexte plutôt que les décrire. Les taxèmes que l’on rencontre dans les textes en diffèrent sans limite prévisible [4].
On admet généralement que les membres d’un même taxème appartiennent au même univers et au même monde. Cela permet de fixer la place des seuils d’acceptabilité. Cependant, les positions standard par rapport aux seuils d’acceptabilité ont beau être intégrées à la description du sémème par des traits évaluatifs, comme /péjoratif/ pour ‘minuscule’, il faut encore que ces traits soient actualisés. Dans certains contextes cependant, ‘minuscule’ peut devenir laudatif, et nous verrons plus loin comment les contextes peuvent inverser les évaluations normées. La lexicographie ne retient que les traits évaluatifs codés “en langue”. Le contexte peut aussi bien les actualiser que les virtualiser ; en outre, il peut propager des traits évaluatifs dans des occurrences de sémèmes qui n’en comportent pas “en langue”. Il suffit pour cela que le contenu évalué soit situé dans un monde et / ou un univers non standard — c’est-à-dire qui ne corresponde pas aux normes implicites de la description linguistique. Retenons donc, si l’on reconnaît des seuils d’acceptabilité, qu’aucun sémème ne peut être situé une fois pour toutes par rapport à un de ces seuils <p. 120>: les statuts évaluatifs varient selon les discours, les genres et les textes, et dans les textes, selon les acteurs et les intervalles temporels [5].
Prenons l’exemple de ‘trop’. Ce grammème peut se définir par sept repérages : sa classe (le taxème des grammèmes quantifieurs), son axe sémantique (l’évaluation), son parcours (dépassement d’un seuil), son évaluation (péjoratif), sa situation dans un univers (celui d’un acteur X), sa situation de monde (le monde Y de l’univers de X), son repère énonciatif (assumé par défaut). Ces sept repérages peuvent être notés par des sèmes : les deux premiers sont des sèmes génériques inhérents ; le troisième un sème spécifique inhérent (par opposition à ‘assez’ et ‘peu’) ; les quatre derniers sont afférents (le quatrième socialement normé ; les trois autres n’étant, en langue, que des places saturables par le contexte). Bref, trop suppose un repérage évaluatif, mais comme la langue propose et que les textes disposent, ils en précisent la place et la teneur.
On objectera que bien des taxèmes ne comportent pas de seuil d’acceptabilité. En langue certes, mais en contexte tout taxème peut être divisé par un seuil d’acceptabilité. Par exemple, dans les Mémoires de Saint-Simon la classe des sièges est divisée et redivisée par de multiples seuils qui varient selon les catégories sociales, voire les circonstances [6]. Plus généralement, tout contenu lexical (et même toute unité sémantique complexe) peut se voir afférer une dimension modale qui la situe dans un univers, dans un monde et dans une zone d’acceptabilité.
Présenter une théorie des structures scalaires excéderait notre propos. Retenons simplement : (i) Nous n’avons pas affaire à du continu, ni véritablement à du graduel, mais à des oppositions déjà discrétisées. Certaines positions intermédiaires peuvent être désignées par l’usage de modificateurs, comme dans presque moyen, ou plutôt petit, mais cet usage n’est pas récursif. (ii) Chaque degré est relatif à une classe de contextes et la position d’un degré par rapport à un seuil évaluatif varie en outre avec ces contextes. Les tests que permettent des modificateurs comme très ou trop sont intéressants mais toujours discutables : si immense peut être paraphrasé par trop grand, il peut l’être aussi par très grand ; ou si très énorme n’est pas attesté, trop énorme peut l’être (c’est trop énorme pour qu’on en doute). (iii) Enfin, les seuils d’acceptabilité ne sont pas inhérents au taxème : ils témoignent de l’incidence de normes dialogiques sur les normes thématiques que le taxème typifie ou caricature. <p. 121>
Cela pourrait introduire une réflexion sur le caractère normatif des représentations du lexique issues de la lexicographie, et même de la lexicologie. Il est douteux que le lexique fasse système au sens fort. Il reflète localement diverses formes de doxa, liées à des genres ou des discours différents voire incompatibles : en cela, tout lexique étendu est hétérodoxe. La polysémie d’acceptions est un effet lexicographique de cette hétérodoxie. Or la linguistique a hérité le caractère normatif de la grammaire, et tend inévitablement à imposer diverses orthodoxies, en usant notamment de normes d’acceptabilité. L’étude sémantique des paradoxes peut contribuer à les relativiser en décrivant l’activité créatrice des contextes.
1.2. Les types de parcours paradoxaux ![]()
Convenons d’appeler doxale la zone en-deçà des seuils d’acceptabilité, et paradoxales les zones au-delà. Ce découpage en zones dépend à l’évidence de normes socialisées des plus traditionnelles, qui situent les évaluations positives dans le juste milieu [7], par d’antiques topoï comme in medio stat virtus ou nequid nimis.
Nous définirons provisoirement le paradoxe, en tant que forme sémantique, par la structure suivante :
|
X /éval.+/ ----------- seuil d’acceptabilité Y /éval.-/ |
Soient deux contenus X et Y, situés l’un au-delà, l’un en-deça du seuil d’acceptabilité en langue. Si X est évalué positivement et Y négativement, la séquence linguistique satisfait à une condition définitoire du paradoxe. Cette condition vaut aussi bien (ou mal) pour les lexies que pour les syntagmes, voire pour des unités plus étendues comme la période.
En général, la contradiction entre les traits évaluatifs en langue et en contexte est suspendue sinon résolue en opérant une dissimilation d’univers [8]. Soient alors deux univers U1 et U2. Nous aurons <p. 122> : si X /éval +/ dans U1, alors X /éval -/ dans U2 ; et de façon converse, si Y /éval -/ dans U1, alors Y/éval +/ dans U2.
Aux trois conditions que nous venons d’énumérer, la présence d’un seuil, la dissimilation d’univers et l’inversion des évaluations, il faut ajouter une quatrième : que les contenus évalués négativement soient situés dans l’univers d’assomption du plus grand nombre, c’est-à-dire appartiennent à une doxa (ou à ce qu’on veut faire passer pour tel). Ces quatre contraintes jointes dessinent une forme sémantique complexe que l’on pourrait figurer ainsi :
|
Ui (individuel) |
Us (social) |
|
Xi /éval.+/ ========== seuil Yi /éval.- / --------------- seuil Zi /éval. - - / |
Xs /éval.- / ========== seuil Ys /éval.+/ ========== seuil Zs /éval.- - / |
Les symboles X, Y et Z désignent des zones évaluatives divisant les taxèmes, et par convention les sémèmes qui y sont placés. Les notations Ui et Us désignent des univers sémantiques représentés, individuel et social respectivement.
Les trois degrés d’évaluation sont le Bon (symbolisé par +), le Mauvais (symbolisé par -) et l’Exécrable (symbolisé par - -) [9]. Ils correspondent à trois sortes de sèmes modaux qui indexent les sémèmes situés dans les zones évaluatives.
Nous distinguons ici deux types de seuils d’acceptabilité : les premiers, figurés par des pointillés doubles, inversent l’orientation évaluative des zones qu’ils séparent ; les seconds, figurés par un pointillé simple, séparent deux zones de même orientation évaluative. Par exemple, la distinction entre Yi et Zi repose sur un seuil d’acceptabilité inférieur qui sépare deux degrés d’évaluation négative : le mauvais (Yi) et l’exécrable (Zi). Ce seuil d’exécration n’est pas attesté pour tous les taxèmes ; parfois, Yi et Zi sont indistincts.
Dans une représentation topologique — dont je ne peux discuter ici les attendus théoriques —, les taxèmes de Ui et Us seraient des formes à trois bassins d’attraction, séparés par deux cols, avec cette différence que le col qui sépare Xi de Yi serait plus élevé que tous les autres, et celui qui sépare Yi de Zi moins élevé que tous les autres (dans Ui et Us). Par ailleurs, parmi les puits de potentiel, Xi et Ys seraient les plus profonds. Les bassins d’attraction se déterminant contrastivement, ‘grand’, ‘moyen’ et ‘petit’, par exemple, entreraient en syncrétisme par opposition à ‘immense’. Dans cette modélisation, les parcours interprétatifs peuvent être décrits comme des bifurcations.
La mise en correspondance d’une zone d’un univers avec une zone de l’autre univers en crée une image <p.123> :
|
Images de Us dans
Ui |
Images de Ui dans
Us |
|
Xs—>Xi Ys—>Zi ou Yi Zs—>Xi |
Xi—>Zs ou Xs Yi—>Zs ou Ys Zi—>Zs Zi—>Ys |
Nous appellerons paradoxaux les parcours qui définissent des images de Us dans Ui, soit : Xs—>Xi, Zs—>Xi, Ys—>Zi, Ys—>Yi. On notera qu’ils inversent tous l’évaluation de la zone source. Ici, l’univers individuel (Ui) semble structuralement pessimiste, car son seuil d’acceptabilité positive est placé fort haut. Telle est la figure hautaine du moraliste.
Par constraste, les parcours qui définissent des images de Ui dans Us sont dits endoxaux.
Cette longue définition du paradoxe convient-elle à la figure de rhétorique du même nom ? Les définitions données par les traités de rhétorique ne sont pas toujours claires ni concordantes, le paradoxe penchant tantôt chez Fontanier vers l’alliance de mots, chez Molinié vers l’antithèse, se résumant chez Dupriez à une affirmation qui heurte les idées courantes.
Nous préférons définir le paradoxe comme une forme sémantique qui résulte d’une interaction codifiée entre thématique et dialogique. Comme les autres formes sémantiques, le paradoxe n’est pas donné mais construit. Sa construction par la perception sémantique et l’interprétation dépend de conditions herméneutiques particulières au texte, mais aussi liées au genre et au discours [10]. Cette forme peut être manifestée dans divers contextes où l’on reconnaît notamment des antithèses (comme ci-dessus), des proportions « conceptueuses » (selon Gracián), des paradiastoles (cf. Douay, 1993).
Elle définit et contraint des parcours interprétatifs. Nous avons dit paradoxaux les parcours Xs—>Xi, Zs—>Xi, Ys—>Zi, Ys—>Yi. En quelque sorte, le premier justifie l’excès, le second valorise l’inacceptable, les troisième et quatrième dévaluent diversement l’accepté : on peut les dire, respectivement, passionnel, subversif, et démystificateur. En voici successivement des exemples. <p. 124>
a) Le parcours passionnel
Chez Chamfort, un parcours fréquent consiste à inverser les évaluations, la zone paradoxale haute (péjorative dans Us) devenant positive dans Ui, et la zone doxale (positive dans Us) devenant négative dans Ui. Voici un exemple d’apparence anodine : « Un petit garçon demandait des confitures à sa mère : ”Donne m’en trop” lui dit-il »(1325) [11]. La valorisation de la zone paradoxale haute par transformation Xs—>Xi est ici évidente. Ajoutons que cette zone est celle des passions : « Toutes les passions sont exagératrices, et elles ne sont des passions que parce qu’elles exagèrent » (72). Or la valorisation des passions ne fait aucun doute : « Les passions font vivre l’homme, la sagesse le fait seulement durer » (82) [12].
b) Le parcours subversif
Un autre parcours paradoxal franchit la distance sémantique maximale, de la zone paradoxale basse de Us à la zone paradoxale haute de Ui. Si par exemple ‘folie’ est situé dans Zs, ‘folie aimable’ l’indexe dans Xi. Parallèlement, si ‘sérieux’ est situé dans Ys, ‘sottise sérieuse’ l’indexe dans Zi. Ces deux parcours sont attestés dans « Amour, folie aimable ; ambition, sottise sérieuse » (158).
Détaillons ce point. L’opposition entre la zone doxale et la zone paradoxale haute apparaît clairement dans l’opposition entre ‘sottise’(/éval.-/) et ‘folie’(/éval.+/). On objectera que cette dernière opposition appartient à la topique du genre, ou du moins qu’elle n’est pas spécifique à Chamfort. Par exemple, La Rochefoucauld notait : « Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il le croit ». Mais dans cette phrase la zone doxale, celle de la sagesse, reste valorisée, alors que dans celle de Chamfort les éléments de la zone doxale sont dévalorisés <p. 125> : la sottise est le contraire de la folie [13] (qui prend alors la place de la sagesse [14], son antonyme traditionnel).
Cela se confirme si l’on considère les autres termes homologués. D’une part, le sérieux n’est pas aimable — et l’on retrouve ici un topos très dix-huitième. D’autre part, l’ambition (sociale) s’oppose à l’amour (individuel) [15]. Du point de vue modal, ‘aimable’ et ‘sottise’ peuvent être indexés dans Ui (par défaut l’univers du narrateur) respectivement en Xi et en Yi. Par suite, ‘amour’ est indexé en Xi ; ‘sérieux’ et ‘ambition’ en Yi, où ils sont l’image de Ys.
Détaillons l’effet des relations contextuelles : ‘aimable’ propage par détermination son trait d’évaluation positive dans ‘folie’ ; il se trouve actualisé dans ‘amour’, où il est socialement afférent. D’autre part,‘sérieux’ se voit afférer le trait /éval.-/ par détermination à partir de ‘sottise’ ; de même pour ‘ambition’, à partir de ‘sottise sérieuse’ (la parataxe favorise la propagation de traits). Ces relations d’activation au sein des syntagmes sont ici renforcées par des relations d’inhibition entre syntagmes : pour la perception sémantique, chacune des trois oppositions renforce les deux autres. Chaque syntagme comprend une isotopie évaluative et le rythme sémantique qu’ils scandent peut se noter : A1 B1 C1 A2 B2 C2.
Soit :
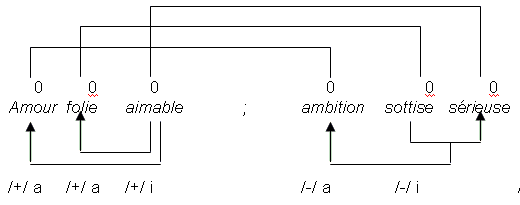
où : i = inhérent, a = afférent ; —> : activation ou propagation ; —o : inhibition.
<p. 126>
c) Les parcours démystificateurs
Ils conduisent du bon (dans Us) au mauvais ou à l’exécrable (dans Ui). Nous en verrons maint exemple dans la section qui suit.
1.3. Les zones de valorisation ![]()
Confirmons à présent le statut de l’opposition entre valeurs sociales et individuelles. Comme la zone paradoxale haute est par définition une zone d’intensité, les contenus y sont rares. Corrélativement, ils sont nombreux dans la zone doxale : ainsi, « Les trois-quarts des folies ne sont que des sottises » (57). Ici l’opposition dialogique /véritable/ vs /apparent/ vient surdéterminer les zones évaluatives : ce qui paraît folie aux yeux de la société n’est bien souvent que sottise pour qui sait discerner la vérité. La formule les trois-quarts des X ne sont que des Y caractérise bien la fonction démystificatrice de la maxime.
On objectera que ‘sottise’ semble positivement évalué dans : « Il faut faire les sottises que nous demande notre caractère » (63). On pourrait voir dans cette occurrence de ‘sottise’ une réplique de Us dans Ui, une mention dans le langage social de ce qui serait une folie selon les normes individuelles. En fait, les sottises sont initiatrices des folies, et tirent leur valeur relative de leur opposition à la froide raison, car « Les trois-quarts des folies ne viennent que de sottises » (75). Soit, mais cette dernière maxime ne suit plus le parcours interprétatif du paradoxe : en effet, au lieu de promouvoir dans un univers personnel un contenu dévalorisé dans un univers social, par une sorte de retour, qui démystifie la démystification elle-même, elle dévalue ‘folie’. Elle est donc endoxale [16]. Il y a là sans doute un effet de pluriel, bien compréhensible si l’on songe que la pluralité est frappée d’une évaluation négative : les sottises sont moins graves que la sottise, les folies sont moins estimables que la folie. Le pluriel les ramène vers le juste milieu doxal, et les diminue en rognant leur excès.
Précisons encore le contenu des zones. Dans la zone doxale de Ui se trouve l’image des valeurs sociales : « Il y a à parier que toute idée publique, toute convention reçue, est une sottise, car elle a convenu <p. 127> au plus grand nombre » (130). Le grand nombre dévalue : « Le public, le public! […] combien faut-il de sots pour faire un public ? » (624).
En revanche la zone paradoxale haute de Ui est celle des valeurs individuelles, et ceux qui s’y meuvent sont des individus d’élite : « On s’effraie des partis violents ; mais ils conviennent aux âmes fortes [17], et les caractères vigoureux se reposent dans l’extrême » (340). Ces individus restent donc de gré ou de force hors du contrat social fondé sur l’échange : « Il en est de la valeur des hommes comme de celle des diamants, qui, à une certaine mesure de grosseur, de pureté, de perfection, ont un prix fixe et marqué, mais qui, par delà cette mesure, restent sans prix, et ne trouvent point d’acheteurs » (88). Dans cette zone, site nous l’avons vu des passions, seul l’inestimable mérite l’estime : « En fait de sentiments, ce qui peut être évalué n’a pas de valeur » (347).
Mais la zone doxale elle-même n’est peut-être telle qu’en apparence, aux yeux du public, et peut aussi avoir pour réplique la zone paradoxale basse de Ui : « Le public ne croit point à la pureté de certaines vertus et de certains sentiments ; et, en général, le public ne peut guère s’élever jusqu’à des idées basses » (90). Cet élever paraît pour le moins ironique : « Il y a des siècles où l’opinion publique est la plus mauvaise des opinions » (92). Dans cette hypothèse extrême, la zone doxale des valeurs sociales correspond à la zone paradoxale basse dans l’univers de référence, celui du narrateur (parcours démystificateur Ys—>Zi). D’où la fréquente suppression de la zone doxale dans Ui, parce qu’elle occupe une position médiane.
Cette hypothèse est confirmée par des réflexions comme : « Voyez la faveur que le gouvernement donne aux idées de gentilhommerie. Cela est venu au point qu’il n’y a plus que deux états pour les femmes, femmes de qualité ou filles ; le reste n’est rien. Nulle vertu n’élève une femme au dessus de son état. Elle n’en sort que par le vice » (232). Ou encore : « M. me dit un jour plaisamment, à propos des femmes et de leurs défauts : “Il faut choisir d’aimer les femmes ou de les connaître : il n’y a pas de milieu” » (1027) [18].
Dans d’autres cas, la distinction entre zone doxale et zone paradoxale basse reste maintenue <p. 128> : « En tout, lorsque l’on brise le joug de l’opinion, c’est rarement pour s’élever au-dessus, mais presque toujours pour descendre au dessous » (210) [19]. La forme d’interaction entre thématique et dialogique que nous étudions se corrèle ici à la dialectique : dans la vie des acteurs narratifs, le pire est presque toujours sûr.
Étendons enfin notre description aux classes sémantiques qui ne comportent pas de triple seuil évaluatif en langue. Soit le taxème ‘pire’, ‘mauvais’, ‘bon’, ‘meilleur’. De ‘bon’ à ‘meilleur’, aucun seuil d’acceptabilité n’impose d’inversion évaluative entre zones doxale et paradoxale.
Mais si chez Chamfort ‘pire’ se trouve dans la zone paradoxale basse (cf. 92), cherchons où se trouve ‘meilleur’ : « M. disait : “Les femmes n’ont de bon que ce qu’elles ont de meilleur”» (628). Le contexte impose ici un seuil d’acceptabilité qui sépare le ‘meilleur’ du ‘bon’, indexé ici dans la zone doxale de Ui par un sème afférent /péjoratif/. Plus précisément, l’occurrence de ‘bon’ revêt simultanément deux acceptions, par une sorte de syllepse : ‘bon n°1’ qui équivaut localement à ‘meilleur’, et ‘bon n°2’, accessible par inférence, équivaut localement à ‘mauvais’. On voit l’incidence du contexte (tel qu’il est structuré par les normes individuelles du style) sur la structure lexicale, qui en théorie relève de la langue : il confère simultanément au même mot deux acceptions contradictoires. On peut rapporter ces transformations évaluatives à l’opposition entre deux univers, celui du public, et celui du narrateur délégué, M… :
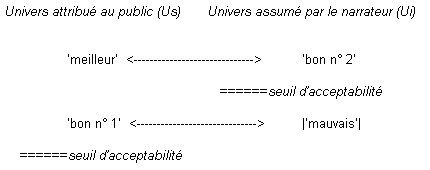
Ainsi, ‘bon n°2’ est la réplique, dans l’univers du narrateur, de ‘meilleur’ dans l’univers du public. La dénivellation entre les seuils évaluatifs témoigne de l’élitisme du narrateur (pour l’espace évaluatif supérieur) <p. 129>, et de son pessimisme (pour l’espace inférieur). D’où l’effet de démystification : le pire, sinon toujours sûr, reste souvent vrai.
Certes, cette disposition peut être rapportée aux genres gnomiques, où il n'est pas rare que le pire, dans un univers, égale voire dépasse le meilleur dans un autre [20]. Mais si le dédoublement des univers et la dénivellation des seuils relève du genre de la maxime, l’usage de cette norme dialogique reste original et peut être rapporté au style. Faut-il en conclure paresseusement que chez Chamfort, la critique de la société se “traduit” ainsi par des remaniements sémantiques en contexte ? Allons plus — ou moins — loin : elle consiste en cela.
1.4. Les paradoxes doubles et les afférences par
homologation ![]()
Nous avons vu avec Amour, folie aimable ; ambition, sottise sérieuse qu’une maxime pouvait recéler plusieurs paradoxes. L’homologation des termes qui se trouvent placés dans les mêmes zones conduit alors à des effets contextuels supplémentaires, d’ordre métaphorique : on relève des propagations, des sélections ou des mises en relief de sèmes.
Le cas plus simple est celui de la proportion aristotélicienne (A est à B comme C est à D). Ainsi, « La menace du rhume négligé est aux médecins ce que le purgatoire est aux prêtres, un Pérou. » (267). Glissons sur la vente des indulgences, et la comparaison implicite des médecins aux prêtres [21], qui dévalorise inévitablement ces derniers, pour venir à celle du rhume et du purgatoire. De redoutable, le purgatoire devient négligeable comme un rhume, ce qui réalise le parcours Zs—>Yi.
Chez Chamfort, les dévôts et même la grâce se trouvent aussi dans la zone paradoxale basse, où ils voisinent avec la sottise. Qu’on en juge : « M... me disait que Mme de C…, qui tâche d’être dévote, n’y parviendrait jamais, parce que, outre la sottise de croire, il fallait, <p. 130> pour faire son salut, un fond de bêtise quotidienne qui lui manquerait trop souvent ; et c’est ce fond, ajoutait-il, qu’on appelle la grâce » (1200). Résumons crûment : la grâce est à la foi ce que la bêtise est à la sottise. Le premier parcours paradoxal est imposé par sottise de croire (Ys—>Yi) et redoublé par celui établit l’équivalence entre ‘bêtise’ et ‘grâce’ (Ys—>Yi). Cette équivalence par homologation révèle une double antithèse, de l’humain au divin et du durable au ponctuel (la grâce, depuis saint Paul, est traditionnellement soudaine).
Ces afférences par homologation sont fréquentes dans les maximes impies : le jeu avec la censure se traduit ainsi par un parcours interprétatif plus long. À dix-sept ans, Chamfort, fils naturel d’un chanoine de la Sainte Chapelle, reçoit le petit collet mais refuse la prêtrise, en ces termes un peu vifs que rapporte Ginguené : « Je ne serai jamais prêtre : j’aime trop le repos, la philosophie, les femmes, l’honneur, la vraie gloire ; et trop peu les querelles, l’hypocrisie, les honneurs et l’argent » (in Dagen, éd., 1968, p. 10). Comme dans une simple proportion, les relations paradoxales peuvent s’établir d’une part entre les contenus situés sur la même isotopie (A et B, C et D), d’autre part entre contenus homologues sur des isotopies différentes (A et C, B et D). Voyons les premières. Le premier couple antonymique (repos, querelles) est codifié et sert donc d’ilôt de confiance pour établir les antonymies qui vont suivre. L’opposition entre la philosophie et l’hypocrisie sélectionne dans ‘philosophie’ les traits /moral/ et /aléthique/. On se félicitera ensuite que les femmes n’aient pas de contraire, bien que cela suffirait à nos contemporains pour accuser le clergé de bougrerie. Enfin, l’opposition de ‘l’honneur’ aux ‘honneurs’, outre qu’elle rappelle la dévaluation attachée au pluriel [22], est articulée par l’opposition entre l’individuel et le social, l’intérieur et l’extérieur. De même pour l’opposition ultime entre la vraie gloire et l’argent [23].
Les énumérations favorisent les propagations de traits, et là où il n’existe pas de trait sémantique commun qui puisse être actualisé, les parcours interprétatifs font le détour par des topoï. Si l’on considère <p. 131> la première énumération, on relève du premier terme au deuxième le topos de l’otium philosophique ; du deuxième au troisième, on conclut que la philosophie naturelle s’accommode bien du plaisir (à la différence des traditionnelles morales de la privation) ; du quatrième au cinquième, que la vraie gloire est l’estime de soi. La seconde énumération convoque les topoï anticléricaux classiques : les prêtres trahissent la fraternité, sont hypocrites, vaniteux et cupides. Pour cela, elle mêle des contenus de la zone doxale de l’univers des valeurs sociales (les honneurs et l’argent) et de sa zone paradoxale basse (les querelles et l’hypocrisie). Pour leur part, les honneurs et l’argent se trouvent dévalorisés de façon convergente, et par leurs voisins d’énumération, et par leurs antonymes dans l’énumération opposée.
Ainsi le paradoxe, en tant que forme sémantique, peut se trouver réalisé dans diverses dispositions morphosyntaxiques qui se laissent ramener à deux grands types : la juxtaposition des opposés et l’adversation des parasynonymes.
1.5. Vers une restructuration du lexique ? ![]()
Une présentation même succinte du lexique de Chamfort excéderait les objectifs de cette étude. Retenons simplement, que comme tout poète [24], Chamfort détruit des structures lexicales et les reconstruit dans un nouveau désordre.
Par exemple l’usage des proportions crée des classes inédites, comme celle où figure ‘dentelles’ : « Il faut être juste avant d’être généreux, comme on a des chemises avant d’avoir des dentelles » (160). Or, « Un homme de lettres, disait Diderot, peut avoir une maîtresse qui fasse des livres ; mais il faut que sa femme fasse des chemises » (587). Voilà donc les maîtresses, les dentelles, les livres et la générosité dans la zone paradoxale haute, tandis que les femmes, les chemises, et la justice se côtoient dans la zone doxale. D’un côté le superflu si nécessaire, l’art et les passions, de l’autre ce qui n’est qu’utile et social [25]. <p. 132>
Par ailleurs, des relations d’antonymie ou d’opposition sont presque annulées par des paradiastoles. La célébrité est une diffamation (682), un châtiment du mérite et une punition du talent (333). Quant au grand monde, c’est un mauvais lieu (820), et « Les gens du monde ne sont pas plus tôt attroupés qu’ils se croient en société » (192).
Est-ce à dire cependant que Chamfort porte atteinte au lexique de la langue ? Les linguistes estiment généralement que les structures lexicales relèvent de la structure linguistique ; c’est fort douteux, si l’on considère les variations contextuelles que les textes produisent. Elles relèvent bien plutôt de normes sociolectales [26]. Certes, Barthes disait que le lexique est de la doxa figée ; l’effet des paradoxes serait alors de dissoudre ce figement. Son propos mérite cependant d’être relativisé [27], car ce figement même est relatif à des discours et à des genres, et il faut se garder de la conception lexicographique du lexique, qui reflète toujours un travail normatif d’uniformisation de la langue.
Du moins, dans notre corpus, les paradoxes remanient tout d’abord ces grandes classes lexicales que l’on appelle les dimensions, notamment les dimensions évaluatives. Par les parcours analogiques entre les domaines sémantiques, ils créent des connexions inédites. Enfin, au sein des taxèmes, ils déplacent, suppriment ou créent <p. 133> des seuils d’acceptabilité. Leurs effets s’étendent donc à tous les niveaux de la paradigmatique.
Cependant, nous n’avons pas affaire à une réélaboration du lexique du français, mais à un corpus dont le lexique est régi par deux normes : la première est présentée comme personnelle ou du moins individuelle, la seconde comme convenue (par des expressions comme : ce qui est reçu (397) ou en dépit du proverbe (332)). Mais rien n’atteste qu’il en soit ainsi : si conventions il y eut, nous n’en voyons ici qu’une image elle-même conventionnelle. En somme, Chamfort, et nos moralistes avec lui mettent en scène une doxa, la figurent sous des formes repoussantes et dramatisent leur affrontement avec elle. Le narrateur triomphe ainsi de la sottise doxale que l’auteur a créée. Ainsi, unifiant des jugements épars [28], les instituant en puissance trompeuse, le paradoxe engendre la doxa.
L’anticonformisme de Chamfort s’appuyait lui-même sur de solides traditions : depuis longtemps les passions étaient mises au-dessus de la raison, et l’éloge de la folie se portait fort bien. Mais aujourd’hui qu’un anticonformisme soft et light fait partie des valeurs universellement vantées par les publicitaires, il est difficile de restituer l’effet subversif des paradoxes de Chamfort.
2. Les composantes sémantiques ![]()
Les relations sémantiques en contexte doivent être rapportées à l’ensemble du corpus, car le global détermine le local. En d’autres termes, les relations microsémantiques ne peuvent être corroborées voire identifiées que si l’on tient compte de l’espace du recueil (comme unité macrosémantique). Complétons donc notre analyse de la thématique, puis de la dialogique.
2.1. Thématique et topique ![]()
Tout paradoxe suppose naturellement une doxa sociale, voire l’institue. Par contraste, il définit une doxa individuelle <p. 134> qui s’y oppose. À ces deux doxa s’en ajoute une troisième, celle sur laquelle s’appuie le moraliste pour mettre en scène les deux premières : elle est faite de jugements ordinaires, qui ne sont pas infirmés ni approuvés comme tels, et échappent ainsi à l’affrontement des valorisations antithétiques. En d’autres termes, elle constitue le fond sémantique sur lequel se détache la forme du paradoxe. On peut appeler topique le secteur de la thématique dont elle relève. Deux exemples vont permettre de s’en éclaircir :
(i) « M..., connu pour son usage du monde, me disait que ce qui l’avait le plus formé, c’était d’avoir su coucher, dans l’occasion, avec des femmes de 40 ans, et écouter des vieillards de 80 » (700). L’opposition ‘coucher’ vs ‘écouter’ paraît originale, mais n’en réarticule pas moins la distinction traditionnelle entre le corps et l’esprit [29]. Quant à l’opposition entre 40 et 80, elle reprend l’antique topos qu’une femme n’est que la moitié d’un homme (d’où par exemple l’expression familière ma moitié ) [30]. Mais elle s’approprie au style de la maxime chez Chamfort, car ici 40 et 80 sont situés dans la zone paradoxale haute : relativement à l’opinion commune, ces chiffres dépassaient — il serait discourtois d’y insister — le seuil d’acceptabilité inférieur [31]. Ils se trouvent donc dans la zone paradoxale basse de l’univers public, et dans la zone paradoxale haute de l’univers de M... : l’inversion des valeurs est ici maximale (Zs—>Xi). <p. 135>
(ii) Un autre lieu commun se trouve dans l’opposition entre les fictions et l’histoire : « L’amour plaît plus que le mariage, par la raison que les romans sont plus amusants que l’histoire » (391). Elle trouve sa source dans la Poétique d’Aristote [32]. On la retrouve naturellement chez divers contemporains de Chamfort, par exemple Rivarol : « La raison est historienne, mais les passions sont actrices » (1881, p. 237) [33]. Mais chez Chamfort, elle se trouve surdéterminée par l’opposition entre zones doxale et paradoxale : comme nous l’avons vu, la raison se place dans la première, l’amour dans la seconde (dans Ui comme dans Us, mais avec des évaluations inverses).
Cela souligne une aporie du paradoxe : pour dévaluer une doxa, on est obligé de s’appuyer sur une autre, et la critique des idées reçues s’appuie, inévitablement peut-être, sur un sens commun si banalisé qu’il reste inaperçu ; d’autant plus que la langue elle-même est sans doute faite de doxa invétérées, dont naturellement aucun texte ne s’exempte.
2.2. L’énonciation représentée et les narrateurs ![]()
Nous ne pouvons retracer ici l’évolution de la gnomè antique, ni le long chemin qui transforme la sententia en bon mot. La sentence est générale et intemporelle comme un proverbe, puisque la sagesse vit ou meurt de vérités éternelles, alors que le mot d’esprit est situé dans un hic et nunc : non seulement il se dit à propos, mais il se rapporte avec ses circonstances.
Bien des mots d’esprit sont des paradoxes, et par définition le paradoxe est situé par rapport à deux univers qu’il faut bien situer. Deux, pour l’essentialisme qui s’exprime traditionnellement dans la sentence, c’est au moins un de trop : quelle place reste-t-il aux vérités éternelles dans l’affrontement de deux vérités relatives ? <p. 136>
Les deux univers ne sont évidemment pas assumés de la même manière par les foyers énonciatifs. Quand ils renvoient à des personnes, on peut les appeler des énonciateurs représentés. Chez Chamfort, l’univers Ui correspond à des énonciateurs individuels, comme je, bien sûr, mais aussi à des acceptions singulières de on ou de vous. Les noms propres se divisent en deux groupes : ceux de personnes, comme Diderot, et ceux qui sont abrégés en leur initiale. Parmi eux, il faut faire une mention spéciale pour M…, ce personnage dans lequel Camus a eu tôt fait de voir le héros d’un “roman inavoué” (1944, p. v), puis Chamfort lui-même, sans doute parce qu’il est cité sauf erreur cent quarante-cinq fois. On pourrait objecter qu’il est d’autres M.…, comme l’académicien (981) ou l’intendant (537), et que M… tout court réfère à divers Messieurs, non à un porte-parole officieux de Chamfort. Mais tous les personnages, même s’ils correspondent à des personnes historiques représentent aussi bien ou aussi mal leur auteur, et ceux qui nous paraissent “partager ses idées” ne devraient jouir d’aucun privilège.
Abrégés ou non, les noms propres ont un effet d’attestation, et lient la maxime à des circonstances : c’est cette mise en situation énonciative qui nous importe ici. Que l’auteur délègue à des personnages ce que l’on croit ses pensées, cela peut passer pour un retrait, voire, pour certaines maximes subversives, une prudence. Nous préférons voir là une stratégie d’individualisation, et le premier fragment du recueil, sous le titre apocryphe de Maximes générales, sans doute donné par Ginguené, critique précisément la généralité de la maxime : « Le paresseux et l’homme médiocre […] donnent à la maxime une généralité que l’auteur, à moins qu’il ne soit lui-même médiocre, ce qui arrive quelquefois, n’a pas prétendu lui donner […] Mais le grand naturaliste, l’homme de génie voit que la nature prodigue des êtres individuellement différents » (1). En situant le paradoxe par rapport à un foyer énonciatif précis, Chamfort marque une rupture avec le caractère sapientiel et parémiologique de la maxime. La critique de la généralité concorde avec celle de la doxa qui s’en repaît, et prépare un éloge de la pensée individuelle. Sans conclure — ce serait simplifier — que le paradoxe transforme la sentence de proverbeen mot d’esprit, retenons que l’évolution de la maxime chez Chamfort contribue au mouvement général de subjectivisation des formes artistiques qui caractérise encore notre modernité. <p. 137>
2.3. La dialectique et l’histoire de l’humanité ![]()
Les Lumières ont voulu s’émanciper de l’optimisme inquiet et parfois frénétique de la Contre-Réforme. Dépassant le pessimisme augustinien dont La Rochefoucauld avait fait une marque singulière de la maxime française, Chamfort fait retour à un pessimisme antique que rien ne tempère plus, avec une violence anarchique qui influencera les nihilistes allemands, comme Schopenhauer et Nietzsche.
Or la forme sémantique du paradoxe, qui en synchronie rendait compte des dissimilations modales, rend compte en diachronie des différences d’évaluation entre les intervalles du temps représenté. Ce qui était l’univers des valeurs individuelles devient le temps passé, voire celui des origines, et celui des valeurs sociales le temps présent. En d’autres termes, aux deux univers Ui et Us correspondent ou se substituent deux chronotopes T1 et T2.
L’évolution historique devient alors un vaste processus endoxal, une dégradation dont seul le paradoxe subversif pourrait nous sauver. Méditons l’ironie du titre Produits de la civilisation perfectionnée, donné à un ouvrage qui fustige non seulement le présent, mais l’état social lui-même : « La société n’est pas, comme on le croit d’ordinaire, le développement de la nature, mais sa décomposition et sa refonte entière […] » (8)Ou bien s’agit-il de perfectionner la civilisation en la faisant retourner à la nature? . Rien de positif dans cette refonte : « Le genre humain, mauvais par sa nature, est devenu plus mauvais par la société […]» (307).
Seules témoignent de la nature perdue les passions humaines, ce qui explique leur valeur éminente (et leur position dans Xi) : « L’homme, dans l’état actuel de la société, me paraît plus corrompu par sa raison que par ses passions. Ses passions (j’entends celles qui appartiennent à l’homme primitif) ont conservé, dans l’ordre social, le peu de nature qu’on y retrouve encore » (7 ; voir aussi 8, 9). L’amour passion, loin d’être comme l’ont prétendu quelques esprits chagrins une faute originelle, est au contraire un retour à la nature, version laïque de la rédemption [34] : « Quand un homme et une femme ont l’un pour l’autre une passion violente, il me semble toujours que, quels que soient les obstacles qui les séparent, un mari, des parents, etc., les deux amants sont l’un à l’autre de par la nature, qu’ils <p. 138> s’appartiennent de droit divin, malgré les lois et conventions humaines » (357). L’amour réalise un paradoxe aussi bien modal que temporel : comme valeur individuelle, il transgresse les conventions sociales ; comme témoignage de la nature, du droit naturel ironiquement divinisé, il inverse le déroulement temporel, en réalisant le parcours Ys (le droit divin)—>Xi (la nature).
Le rapport à l’origine détermine le rapport à l’histoire. La philosophie des Lumières confondait ordinairement le temps de l’origine et le temps de l’histoire. Ici l’éloignement des valeurs passées justifie la critique de la noblesse : « La plupart des nobles rappellent leurs ancêtres comme les Cicerone d’Italie rappellent Cicéron » (23) [35].
Plus sérieusement, la Révolution elle-même permet des parcours paradoxaux. Ginguené rapporte ce mot de Chamfort : « La Bastille, Messieurs ? Elle ne fait que décroître et embellir ! » (1795, p. xxxvi), qui réalise le parcours subversif Zs (décroître)—>Xi (embellir). Et surtout, cette phrase suggérée à Sieyès, qui lui doit encore une part de sa célébrité : « Qu’est-ce que le Tiers État ? Tout. Qu’a-t’il ? Rien » [36] ; elle réalise le même parcours subversif Zs (Rien)—>Xi (Tout), si l’on convient que le Tiers État n’est rien pour l’opinion dominante, et qu’il est suprêmement valorisé pour le locuteur. L’ambiguïté de la Révolution, ou celle de Chamfort à son égard, se traduit par un dernier parcours paradoxal que nous n’avons pas encore étudié, et qui franchit certes un seuil, mais en passant de l’exécrable au mauvais. Chamfort écrit à Madame Agasse : « Les hommes marchaient sur leur tête, et ils marchent sur les pieds ; je suis content : ils auront toujours des défauts, des vices même ; mais ils n’auront que ceux de leur nature, et non les difformités monstrueuses qui composaient un gouvernement monstrueux » (Lettre du 15 juillet 1790, éd. Dagen, p. 397). On ne saurait mieux formuler le programme exactement rétrograde (mais non réactionnaire) des jacobins. Cette opération dialectique peut se représenter par un parcours Zs (en T2)—>Yi (en T1), ou bien, si l’on convient que Zi est l’image de Zs, par un parcours de Zi (l’exécrable) à Yi (le mauvais) [37]. <p. 139> Ainsi, le bien n’est-il qu’un moindre mal, et la Révolution désirée permet de passer de l’exécrable au mauvais. Elle rédime quelque peu la dégradation historique, et rétablit, l’espace d’une phrase, la nature. L’ambiguïté de la Révolution tient à celle de la Nature, terme complexe qui concilie le positif et le négatif : si le positif l’emporte, la Révolution établit le paradoxe désiré ; si le négatif domine, elle reste endoxale. Ici, son statut reste indécidable, et l’on pourrait définir la Révolution comme un paradoxe inabouti.
Mais si le passé, puisqu’il est plus proche de l’origine, n’était pas si mauvais ? Chamfort répond à notre question dans la même lettre, deux phrases plus loin : « Faisons durer tout ce qui est bon de l’ancien temps, qui était si mauvais ». Cet autre paradoxe situe le mauvais par rapport à l’opinion commune, et assume le bon (réalisant une fois de plus le parcours subversif Zs—>Xi). Que les deux paradoxes successifs dans cette lettre à Madame Agasse paraissent se contredire (malgré l’identité de leur structure dialectique), cela s’explique si l’on sait que dans la première phrase Chamfort dramatise une de ses positions politiques, et que la seconde conclut sur un ton aimable une lettre passionnée, le genre même de la lettre à une chère amie appelant cette rupture de ton.
2.4. Spécificité de Chamfort et style paradoxal ![]()
Ne surestimons pas cependant les régularités, surtout chez un auteur étranger à l’esprit de système. Les analyses qui précèdent doivent donc être nuancées, pour ne pas tomber d’une mystique de l’auteur dans une obsession de son système stylistique. Les prescriptions d’une langue ou d’un genre ne sont pas également à l’œuvre avec la même force en tout point d’un corpus. Il en va sans doute de même pour le style — si on le définit comme un modèle hypothétique des propriétés idiolectales d’un corpus. Le droit de se contredire, que revendiquait justement Baudelaire, doit être reconnu à tous.
Quand Chamfort écrit : « Il y a plus de fous que de sages, et, dans le sage même, il y a plus de folie que de sagesse » (149), il inverse les évaluations ordinaires chez lui, pour revenir à l’opinion jugée commune. <p. 140> Ici en effet, ‘sages’ et ‘sagesse’ relèvent ici de Xi (comme le confirme leur rareté), alors que ‘fous’ et ‘folie’ se placent dans la zone doxale [38] des valeurs individuelles et sans doute dans la zone paradoxale des valeurs sociales. De même, dans : « Un homme amoureux, qui plaint l’homme raisonnable, me paraît ressembler à un homme qui lit des contes de fées, et raille ceux qui lisent l’histoire » (409). Ici l’histoire et la raison restent homologues, mais sont positivement évaluées, alors que l’amour (valorisé quand il était comparé aux romans, cf. 391) se trouve dévalorisé dans le contexte de ‘contes de fées’.
Bien que leur topique reste homogène aux autres, on relève ainsi chez Chamfort quelques maximes endoxales, qui inversent les évaluations ordinaires dans son œuvre : « Rien n’est un, rien n’est pur » (126).
Ces disparates sont sans doute l’indice de contradictions que le paradoxe ne parvient pas à révoquer. On doute qu’elles puissent faire l’objet d’une conciliation, car toute l’œuvre opère des disjonctions. Et pourtant, elle admet parfois des conjonctions en créant des termes complexes : par exemple, « Dans de certaines amitiés passionnées, on a le bonheur des passions et l’aveu de la raison par-dessus le marché » (316). L’antithèse entre les passions et la raison devient alors une sorte d’oxymore. Cette sorte de synthèse conduit à un étrange équilibre moral, que je n’ose dire paradoxal : « Les stoïciens sont des espèces d’inspirés qui portent dans la morale l’exaltation et l’enthousiasme poétiques » (313). [39] <p. 140>
3. Directions de recherche ![]()
Il ne suffit pas de décrire une forme sémantique, il convient aussi d’en évaluer la significativité. Nous évoquerons trois directions : la comparaison avec un autre auteur de maximes, la réception de Chamfort, enfin le sens du paradoxe dans d’autres genres que la maxime.
3.1. Pour confirmer ces analyses, et puisque l’originalité d’un style ne peut véritablement être appréciée que par la méthode comparative, prenons un instant Rivarol comme faire-valoir. Formulons l’hypothèse qu’en employant le même genre littéraire, il a inversé les rapports entre thématique et dialogique, en évaluant positivement la zone doxale des valeurs sociales, conformément à son axiologie morale et politique. Ainsi, quand il écrit : « La plupart de nos impies ne sont que des dévôts révoltés » (p. 236), il conserve le patron phraséologique traditionnel que l’on trouvait aussi chez Chamfort (cf. 75). Mais là où Chamfort dévaluait la zone doxale, et a fortiori la zone paradoxale basse, Rivarol réévalue la zone paradoxale basse (celle de l’impiété) pour la faire équivaloir à la zone doxale (où se trouvent les dévôts) : il réalise le parcours endoxal Zi—>Ys. Ce retour aux bercail doxal laisse donc les dévôts deux fois démystifiés.
En général, Rivarol dévalue également les zones paradoxales, décrites comme excès (zone haute) ou manque (zone basse), et il valorise la zone doxale. Ainsi dans : « L’homme sage, en fait de religion, ne doit être ni superstitieux ni impie » (p. 236) [40].
Enfin, Rivarol assigne au peuple la zone paradoxale basse (à la différence de Chamfort, pour qui “le plus grand nombre”, également dévalorisé, relevait de la zone doxale). Ainsi, dans : « À mesure que les superstitions diminuent chez un peuple, le gouvernement doit augmenter de précautions et resserrer l’autorité et la discipline » (p. 274) [41]. Donc la doxa est celle des gens de bien, des gouvernements, non du peuple <p. 142> ; et l’énonciateur implicite de la maxime ne marque aucune différence entre les valeurs qu’il assume et celles de la doxa qu’il met en scène.
Retenons que le paradoxe, en tant que forme sémantique, n’est pas lié au genre de la maxime, mais sans doute à une structure idéologique qui apparaît dans divers genres textuels.
3.2. La réception de Chamfort est longtemps restée tributaire de choix idéologiques. Pour les conservateurs, le paradoxe est cynique, car il applaudit l’exécrable ou rabaisse ce qui est bon. Chateaubriand écrit ainsi, pour défendre la “bonne société” de naguère : « il prenait le cynisme de son langage pour la peinture des mœurs de la cour » (Mémoires d’outre-tombe, IV, 12) [42].
Mais Friedrich Schlegel, qui mérita le surnom de Chamfortierende, prévient et tourne en éloge l’accusation de cynisme, quand il fait non sans paradoxe de Chamfort, « un authentique cynique, au sens antique, plus philosophe que toute une légion d’universitaires desséchés » (Fragments critiques, § 111).
Dans cette différence d’évaluation se joue le rapport à la mort. Alors que pour Chateaubriand elle se riait de Chamfort, pour F. Schlegel, c’est Chamfort qui se riait d’elle : il voit en lui un homme de génie, pour « la pensée que le sage doit toujours être vis-à-vis du destin en état d’épigramme [43]» (Fragments critiques, § 59). L’épigramme, et avec lui le paradoxe qui en est une forme ordinaire, devient ainsi un moyen de se dresser contre l’humaine condition, alors que la mort se trouve dans le camp de la doxa, avec les universitaires desséchés. <p. 143>
3.3. Deux voies s’ouvrent en fait pour juger d’une œuvre paradoxale, ou du moins riche en paradoxes, et cela indépendamment des domaines sémantiques qu’elle met en œuvre (politique, religion, etc.) : la voie normative qu’illustrait Chateaubriand, et la voie passionnelle que préconise Schlegel.
Comme il comporte un franchissement de seuil, le paradoxe peut être décrit comme transgression ou comme promotion ; parce qu’il impose une dissimilation d’univers, il porte atteinte à l’unité ontologique : en d’autres termes, le paradoxe ne convient pas au monisme réducteur.
Le paradoxe est intolérable pour la logique comme pour la morale quand elles s’unissent dans une même conception normative. Si l’on estime que l’Être est unique, identique à lui-même et non contradictoire, le paradoxe devient vicieux, car la contradiction ne peut résider que dans un esprit infidèle au vrai. Le principe de non-contradiction fait partie des prétendues “lois booléennes de la pensée” et reste une loi de l’argumentation scientifique.
On ne s’étonnera pas que la logistique russellienne puis le positivisme logique se soient évertués à dissiper les paradoxes. La théorie des types de Russell est consacrée à cette entreprise. Il a discuté de nombreux cas d’école, qui rappellent fort les sophismata scolastiques et il les a résolus en élaborant la théorie des métalangages. Quel que soit l’intérêt théorique de questions comme celle de savoir si le catalogue des catalogues doit se mentionner lui-même, ou si le barbier du régiment doit aussi se raser lui-même (Reichenbach conclut courageusement que ce barbier n’existe pas), ils ne nous ont pas retenus ici, car nous prenons pour objet des textes et non des problèmes de logique. Mais on peut retenir que la chasse aux paradoxes à laquelle se sont livrés tous les grands noms du néo-positivisme avait pour but de rétablir une situation où le langage ne soit susceptible que de vrai et de faux, pour faire comparaître la pensée devant les faits [44]. <p. 144>
Quant à la morale, on sait qu’en ce siècle son magistère est passé aux mains des psy. Certains gourous de Palo Alto, Watzlawick et ses collègues, se recommandant de la théorie du paradoxe du positivisme logique (et notamment de Russell, Carnap et Tarski) qu’ils abordent par la voie pragmatique [45], diagnostiquent gravement : « Là où le paradoxe corrompt les relations humaines, la maladie n’est pas loin » (1972, p. 202) ; perdant leur sang-froid, nos Diafoirus californiens concluent même, à propos de la névrose expérimentale chez le chien de Pavlov : « Le paradoxe montre sa tête de Méduse » (p. 217). Tous nos maux viennent de là, vous dis-je.
S’il ne convient pas au monisme, le paradoxe sera mis à profit par diverses pensées dualistes. La négation de la doxa devient une négation de ce monde et l’affirmation de la zone paradoxale haute la découverte d’une transcendance.
C’est ainsi que l’on peut comprendre, pour une part, la théorie du Witz des premiers romantiques allemands. F. Schlegel donne de “la pensée favorite” de Chamfort cette image : « [il] voyait dans le Witz un succédané de l’impossible félicité, un petit acompte en quelque sorte, que la nature en faillite verserait en dédommagement de la dette honorée du Bien suprême » (ibid.). Schlegel va plus loin en faisant du Witz une fin en soi, comme la vertu, l’amour et l’art, et suggère que Chamfort en aurait senti l’infinie valeur.
Que le paradoxe puisse devenir une voie vers la transcendance, Chamfort en reste un exécrable juge. Mais traditionnellement, et dans la pensée théologique allemande en particulier, le paradoxe a été mis au service de la mystique, en particulier de l’apophase. Il fourmille chez Maître Eckhart et les mystiques rhénans ; il abonde naturellement dans la poésie mystique de l’époque baroque [46]. En France, la tradition augustinienne illustrée par Pascal et l’école de spiritualité inspirée par Bérulle <p. 145> n’ont pas dédaigné d’en user quand elles s’approchaient de la Voie négative.
On trouve sans doute un dernier écho du paradoxe mystique dans ce propos de Jean-Luc Marion : « En théologie, le péché ne résulte pas d’un désir, mais d’un désir trop faible, trop modeste, trop résigné, qui se résigne au fini, quand s’offre l’infini. Il faut donc apprendre à désirer trop et trop haut, […] pour franchir ne serait-ce qu’un instant les frontières irréelles de l’impossible, bref pour entrer dans la réalité qui surpasse toute attente et toute prévision » (Libération, 30.08.93. Ce désirer trop et trop haut dépasse fort la hauteur d’une armoire à confitures, mais ne rappelle-t-il pas le donne m’en trop du petit garçon qui en demandait tout à l’heure à sa mère ?
Ainsi le paradoxe, en tant que forme sémantique, peut opposer et relier deux moments du temps, deux systèmes de valeurs, ou le monde humain et le monde divin. Cela dépend du discours et du genre où il s’emploie. Souvent, il est jugé néfaste ou libérateur, selon que le critique choisit de privilégier un moment du temps, un système de valeurs ou un monde.
Une troisième voie, celle que nous souhaitons avoir empruntée, paraît échapper à ces dilemmes et pourrait être appelée sophistique. Après tout, bien que l’usage des paradoxes en dialectique ait préexisté à la première sophistique, les paradoxes ont toujours été vilipendés sous le nom de sophismes.
Gorgias aurait-il tracé cette voie ? Son Éloge d’Hélène est paradoxal par son titre même, dans une tradition où les femmes enlevées sont toujours accusées d’être consentantes. Son Traité sur le Non-Être est régulièrement vilipendé pour son impiété, car il admet plus d’un point de vue sur l’Être et utilise le paradoxe pour détruire une à une toutes les thèses classiques de l’ontologie.
S’il y a plus d’un point de vue sur l’Être, plus d’un sur la doxa, l’Être ne serait-il qu’une forme de la doxa ? La question elle-même semble un sophisme, mais soulignons ce qu’elle insinue. Le dualisme platonicien récusait la doxa au nom de l’Être : elle n’aurait reflété que des apparences impermanentes. Le programme aristotélicien se contente de la distinguer de la vérité que nous dirions aujourd’hui scientifique, mais maintient qu’elle ne peut juger du vrai. Toute la tradition scientiste, jusqu’au positivisme logique de ce siècle, récuse l’opinion et la fait condamner par le jugement des faits. Le grand projet d’une langue parfaite qui puisse énoncer purement le vrai <p. 146> vise précisément à débarrasser le langage de toute trace de doxa, et nous lui devons les langages formels.
Les romantiques allemands se sont évidemment écartés de ce programme positif, en considérant les hypothèses, voire les vérités scientifiques, comme des mots d’esprit. Friedrich Schlegel considérait Bacon et Leibniz comme des virtuoses du Witz, et ajoutait : « Les plus importantes découvertes scientifiques sont des bons mots de ce genre » (Athenæum, § 220 ; italiques en français dans le texte).
Mais loin de donner accès à un savoir transcendant, ces bons mots ne témoignent-ils pas d’une nouvelle doxa ? Le réalisme invétéré des philosophies occidentales a sans doute une fonction ontogonique : il réifie inlassablement de la doxa, celle d’une élite autoproclamée de la pensée, pour la constituer en Être. La fascination horrifiée pour le paradoxe témoigne peut-être d’un doute secret sur ce processus spéculaire.
Pour la voie sophistique, qui j’en conviens n’a aucune autorité historique [47], les opinions n’ont pas de juge suprême, car nous vivons dans un monde de signes. Dès lors, le paradoxe, simple forme sémantique, peut se décrire et non se juger : on peut même parler de sa morale sans en faire. Le non-réalisme méthodologique et le scepticisme épistémologique que nous résumons sous le nom de voie sophistique sont à nos yeux les conditions d’une description non normative des textes, qui renonce à les rapporter à des conditions de bonne formation, d’acceptabilité ou de vérité. Car le langage n’a pas de rapport avec l’Être et n’est donc pas plus susceptible de vrai que de faux.
Remerciements : J’ai eu la chance de tirer parti des observations de Françoise Douay, Ronald Landheer, David Piotrowski.
<p. 147>
NOTES
[1] Cette œuvre se divise en quatre parties : Maximes et pensées, caractères et anecdotes, qui composent le titre de l’excellente édition Dagen (Paris, Garnier-Flammarion, 1968). Nous la suivons ici, en conservant notamment sa numérotation.
[2] Plus exactement de la dialectique antique, longtemps indistincte de la logique. Le paradoxe servait à démontrer l’erreur d’une théorie en montrant que les conséquences de ses principes conduisent à des antinomies.
[3] On sait que les faits de style ne se limitent pas aux rapports entre le contenu et l’expression, mais intéressent aussi les relations internes à ces deux plans.
[4] Il faut en outre tenir compte des variations dialectales. En français québécois, sans doute à l'image de l'anglais, une bière froide est recevable et attestée. On voit ici l'articulation entre la norme linguistique qui détermine le nombre et la position par défaut des seuils d’acceptabilité, et les autres normes, sociolectales comme idiolectales, qui font varier la position de ces seuils.
[5] L’idée que le langage est un instrument de représentation s’accorde avec le préjugé tenace que le langage est un simple instrument idéographique à l’usage de la pensée rationnelle. Outre que le langage n’est pas un instrument mais un milieu où se déroule notre vie, convenons que l’univers humain est constitué d’appréciations sociales et individuelles, qui pourraient faire l’objet d’une esthétique fondamentale. Elle relève de la linguistique quand elle prend pour objet le matériau linguistique lui-même. Au palier morphologique, toutes les langues comprennent des morphèmes appréciatifs (cf. e.g. l’affixe -acci- en italien). Au palier immédiatement supérieur, le lexique des langues fourmille d’évaluations, et des seuils d’acceptabilité structurent les classes lexicales élémentaires (cf. e.g. des oppositions comme grand / énorme ou froid / glacial), a fortiori les unités phraséologiques, fort nombreuses dans tout texte, qui reflètent et propagent diverses formes de doxa. Au palier de la phrase, on peut considérer que toute prédication est une évaluation. Au palier textuel enfin, l’analyse narrative par exemple a maintes fois souligné l’importance des modalités dites thymiques. En somme, l’esthétique fondamentale définit le substrat sémiotique sur lequel s’édifient les arts du langage, mais demeure en deçà des esthétiques philosophiques. Elle n’a en cela rien de commun avec une fonction esthétique, poétique ou stylistique.
[6] Voir dans la seule année 1699 Fauteuil de l’abbé de Cïteaux aux états de Bourgogne, et Tabouret de la Chancelière.
[7] Cette expression même s’est figée sous l’effet de ces normes ; et cela rappelle que diverses doxa structurent la phraséologie, et même le lexique.
[8] Il s’agit ici d’univers d’assomption et non de croyance. Un univers d’assomption est l’ensemble des propositions attribuées, fut-ce par défaut, à un acteur (ou à un agoniste) — cf. l’auteur 1971, et 1987, pp. 197 sq.). En revanche, un univers de croyance est défini par R. Martin comme l’ensemble des propositions qu’un locuteur (réel) croit vraies au moment de son énonciation, ou veut faire passer pour telles. Faute de théorie de la sincérité, nous en restons aux énonciateurs représentés, et nous garderons de confondre Chamfort avec ses personnages.
[9] On s’étonnera peut-être de l’absence de l’Excellent. Elle tient peut-être à notre corpus, car chez Chamfort tout ce qui n’est pas excellent n’est pas bon.
[10] Cf. sur ce point l’auteur et coll., 1994, ch. I. Nous nous écartons de Riffaterre : « Le paradoxe est une caractéristique formelle et sémantique : inscrit dans le texte, il est évident, ce qui nous épargne tout recours à des explications idéologiques ou esthétiques.» (1992, p. 221). Il nous semble qu’aucune forme sémantique n’est évidente par elle-même.
[11] Je rencontre ici par un autre biais F. Douay (1987, pp. 36-39), qui s’appuie sur Ducrot (Les échelles argumentatives, Paris, Minuit, 1980) et souligne le rôle des degrés extrêmes dans les “maximes héroïques” pour lesquelles “rien n’est trop” (p. 38), et cite en exemple : « Il y a des héros en mal comme en bien » (La Rochefoucauld, maxime 185).
[12] L’opposition entre ‘vivre’ et ‘durer’ entraîne l’afférence dans ‘vivre’ des sèmes aspectuels /ponctuel/ et /itératif/, par opposition à /duratif/ ; et, propagé à partir de ‘passions’, où il est inhérent, du sème /intense/ qui situe ‘vivre’ dans la zone paradoxale de U1. On se rappelle que De Gaulle, dans son message de Noël 1942, paraphrasait ainsi Chamfort : « Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu ».
[13] Cf. « M... disait, à propos de Mme de... : “J’ai cru qu’elle me demandait un fou, et j’étais prêt de le lui donner ; mais elle me demandait un sot, et je le lui ai refusé tout net” » (755).
[14] Peut-être se succèdent-elles comme les âges de la vie. M… résume son expérience en disant : « J’en ai conclu que le repos, l’amitié et la pensée étaient les seuls biens qui convinssent à un homme qui a passé l’âge de la folie » (821).
[15] En témoignait déjà l’apocryphe Discours sur les passions de l’amour : « Les passions qui sont le plus convenables à l’homme et qui en renferment beaucoup d’autres sont l’amour et l’ambition : elles n’ont guère de liaison ensemble ; cependant on les allie souvent ; mais elles s’affaiblissent l’une l’autre réciproquement, pour ne pas dire qu’elles se ruinent » (in Pascal, Œuvres complètes, Paris, Seuil, p. 285). Ou encore cette notation de La Rochefoucauld : « On passe souvent de l’amour à l’ambition, mais on ne revient guère de l’ambition à l’amour » (490)
[16] J’adapte ce terme de Hermagoras, qui l’employait pour désigner ce qui s’accorde avec l’opinion commune.
[17] Ici se trouve sans doute l’origine du titre que Giono, grand lecteur de Chamfort, donna à son roman.
[18] On retrouve ici l’antithèse traditionnelle du cœur et de la raison, et, implicitement, le topos de l’heureuse ignorance.
[19] Cette remarque ne vise pas les personnes de mérite, mais les princes et les femmes : « Quand les princes sortent de leurs misérables étiquettes, ce n’est presque jamais en faveur d’un homme de mérite, mais d’une fille ou d’un bouffon. Quand les femmes s’affichent, ce n’est presque jamais pour un honnête homme, c’est pour une espèce » (210).
[20] Cf. par exemple des proverbes comme « l'enfer de mon mari plutôt que le paradis de ma famille », ou « l'enfer de Sanaa plutôt que le paradis de Damas » (Ismail ibn Ali al-Akwa, éd. Al-Amtal al-Yamaniyya, n° 5771 et 5772, d'après Pagnini, 1990).
[21] Elle est fort banale (cf. e.g. le préambule de Ficin à son commentaire au Banquet), car ils se sont longtemps côtoyés aux chevets des mourants, mais son orientation métaphorique est ici inversée : s’il était convenu que les prêtres fussent les médecins de l’âme, nul n’a jamais prétendu que les médecins soient les prêtres du corps.
[22] Cf. Flaubert : « Les honneurs déshonorent » (Lettre à Louise Colet).
[23] La fortune, qui signifie à l’époque une distinction méritée, s’oppose à la richesse : « En renonçant au monde et à la fortune, j’ai trouvé le bonheur, le calme, la santé, et même la richesse ; et en dépit du proverbe, je m’aperçois que qui quitte la partie la gagne » (332).
[24] Jean Dagen (1968, p. 38) n’hésite pas à parler d’une forme d’expression poétique.
[25] Ces classes engendrent aisément des maximes apocryphes
comme : « Il faut être juste avec sa femme et généreux avec sa
maîtresse », ou « Les maîtresses sont aux épouses ce que les dentelles
sont aux chemises ».
Un
point de méthode s’impose ici : à quelles conditions rapprocher deux
maximes, et pourquoi supposer que les chemises de la maxime 167 soient les
mêmes que celles de la maxime 587 ? Si nous présumons l’unité du recueil
que nous prenons pour corpus, cela traduit non pas une volonté normative, mais
le principe herméneutique que le global détermine le local. Les techniques
interprétatives, comme ici la recherche de passages parallèles, se fondent sur
cette présomption. On les applique certes pour éclairer les passages obscurs,
mais à vrai dire aucun texte littéraire n’est clair. Nous cherchons à décrire
des normes sémantiques propres au texte de Chamfort, et, loin de masquer son
hétérogénéité, ou plus exactement son hétérodoxie interne, nous cherchons à la
souligner (cf. infra, § 3.1.).
[26] Relèvent sans doute du système linguistique les règles structurales de combinaison des morphèmes au sein du mot et de la lexie, mais l’idée d’un lexique de la langue est sans doute un fantasme lexicographique.
[27] Le retrait sapientiel de la sentence classique, la sécession du sage, devinrent au siècle dernier l’affrontement entre l’Artiste et les Philistins, dont les aphorismes de Nietzsche témoignent à leur manière. Barthes a marxisé ce thème romantique en un affrontement entre l’Intellectuel et la (Petite) Bourgeoisie. Combinée à la thèse que la langue faite de doxa, cette conception devait le conduire à conclure dans sa leçon inaugurale au Collège de France que la langue est fasciste. Sans doute conscient de l’ineptie de cette thèse, il ne s’enferma pas pour autant dans un silence « de gauche ».
[28] Par jugement, nous entendons simplement la mise en relation de deux unités sémantiques par une relation typée. Une évaluation est une sorte de jugement.
[29] Le comte de Chesterfield, contemporain de Chamfort, conseillait à son fils de “feuilleter” les hommes le jour et les femmes la nuit.
[30] La courtoisie voudrait que cette moitié fût une allusion au mythe de l’androgyne (Banquet 189-190). Mais les âmes viriles
n’ont sans doute pas supporté le statut de demi-portion. Cette moitié semble
bien plutôt une proportion biblique commune aux religions du Livre. Le Coran
commande de laisser au fils mâle la portion de deux filles (IV, 12), établit
que la moitié des biens d’une épouse décédée sans descendance appartient au
mari (IV, 13) ou encore que le témoignage d’un homme vaut celui de deux femmes.
Les femmes ne valent le double que pour l’impureté : par exemple, chez les
juifs d’Ethiopie, on préconise 80 jours d’éloignement si la mère accouche d’une
fille, et 40 si c’est un garçon (ce qui rappelle en outre que 40 et 80 sont des
chiffres topiques).
Quoi
qu’il en soit, chez Chamfort une femme ne vaut qu’un demi philosophe :
« Quand Mme de F... a dit joliment une chose bien pensée, elle croit avoir
tout fait ; de façon que, si une de ses amies faisait à sa place ce
qu’elle a dit qu’il fallait faire, cela ferait à elles deux une
philosophie » (1.000).
[31] Ces âges étaient réputés trop élevés, respectivement pour un homme (cf. La Fontaine : “Un octogénaire plantait...”) et pour une femme (ce dont témoigne encore Balzac dans La femme de trente ans ).
[32] Cf. 1451 b 5 : « La poésie est une chose plus philosophique et plus noble que l’histoire » ; et 1459 a 22 sq. Aristote contredit ici son maître (cf. La République, I, X), mais pour prononcer à sa suite un éloge de la généralité, déliée du contingent. Cela sera compris par les Modernes comme un éloge de la fiction — source, selon Riccoboni, traducteur de la Poétique (1589), d’une fabulosa delectatio — peut-être parce que toute fiction est passionnelle.
[33] Le substrat axiologique commun apparaît dans la proportion : le mariage est à l’amour ce que la raison est à la passion, ou l’histoire à la fiction. C’est pourquoi le romanesque doit conduire à l’adultère, et Emma Bovary sera l’illustration majeure de cette idée reçue.
[34] Ce vieux thème gnostique, passé des Bogomiles aux cathares, dans la poésie provençale, puis à Dante et Pétrarque, sera usé jusqu’à la corde par le romantisme, et obsède aujourd’hui westerns et sit-coms.
[35] Cf. aussi cette anecdote magistrale : « M. le prince de Charolais ayant surpris M. de Brissac chez sa maîtresse, lui dit : “Sortez!”. M. de Brissac lui répondit : “Monseigneur, vos ancêtres auraient dit : “Sortons”.» (927). Cette évolution n’est pas limitée à la noblesse : « En parcourant les mémoires et monuments du siècle de Louis XIV, on trouve, même dans la mauvaise compagnie de ce temps-là, quelque chose qui manque à la bonne d’aujourd’hui » (178).
[36] Chamfort demandait : « Trouvez-vous là des longueurs ? ». Sieyès se contenta d’ajouter un plat : « Que veut-il ? Quelque chose ! ».
[37] Ce deux parcours ne sont pas à proprement parler paradoxaux, le premier parce qu’il ne réalise pas d’inversion évaluative, le second parce qu’il ne met pas en œuvre une dissimilation d’univers.
[38] ‘Fou’ est ordinairement mélioratif chez Chamfort (cf. supra n. 13 : « J’ai cru qu’elle me demandait un fou » 755) ; mais ‘fous’ est péjoratif, sans doute parce que le pluriel ne convient pas aux âmes fortes. Ici, par un effet de contexte, le trait /péjoratif/, propre à ‘fous’, se propage à ‘folie’ (qui comporte ordinairement chez Chamfort le trait /mélioratif/). Au palier lexical, nous relevons ici un emploi qui se distingue de l’acception ordinaire chez Chamfort.
[39] Cioran reprend cela dans sa manière : « Stoïcisme de
parade : être un passionné du “Nil admirari”, un hystérique de
l’ataraxie » (Syllogismes de l’amertume,
Paris, Gallimard, 1953, p. 37).
La
filiation de la raison et des passions chez Vauvenargues était déjà une forme
de conciliation : « Nous devons peut-être aux passions les plus
grands avantages de l’esprit » (Réflexions et Maximes, 151) ; « Les
passions ont appris aux hommes la raison » (154). La philosophie est
elle-même reconnue pour une entreprise passionnelle quand Sade (« On
déclame contre les passions sans songer que c’est à leur flambeau que la
philosophie allume le sien », apud Camus, 1944, p. iv) répond à Chamfort
(« Le philosophe qui veut éteindre ses passions ressemble au chimiste qui
voudrait éteindre son feu » (73)).
[40] L’éloge de ce que Stendhal appelait le plat juste-milieu éclate dans : « La nature n’ayant plus rien de nouveau à offrir à l’homme qui pense et qui vieillit, et la société encore moins, il ne doit demander que l’air et l’eau, le silence et l’absence, quatre choses sans goût et sans reproche » (p. 247).
[41] Le peuple ne parvient pas pour autant à la zone doxale, car il est incapable de raison, ou du moins elle lui est contraire : « Les peuples peuvent, comme Didon, gémir d’avoir trouvé la lumière » (p. 285) ; « les lumières ne rendent pas les peuples heureux.» (p. 247). La zone doxale est occupée comme on le voit par la sagesse, la religion tempérée, et les gouvernements.
[42] Dans sa fureur, Chateaubriand voulut même déposséder
Chamfort de la mort qu’il avait choisie pour “rester un homme libre” : «
Furieux de retrouver l'inégalité des rangs dans le monde des douleurs et des
larmes, condamné à n'être qu'un vilain
dans la féodalité des bourreaux, il se voulut tuer pour échapper aux
supériorités du crime ; il se manqua : la mort se rit de ceux qui
l'appellent et qui la confondent avec le néant » (ibid.). Il est vrai qu’il se rata, mais la médecine fit le reste et
il mourut de ses blessures.
Sainte-Beuve
diagnostiqua pour sa part une “ulcération de l’âme”, jugea que Chamfort
« n’avait pas désiré assez tôt la mort de Robespierre pour mériter d’en
être le témoin », et l’accusa enfin d’avoir voulu entraîner dans sa propre
chute l’humanité tout entière…(Causeries
du lundi, 1851, Paris, Garnier, t. IV).
[43] En français dans le texte. Chamfort dit seulement que l’honnête homme « doit être plus gai qu’un autre, parce qu’il est constamment en état d’épigramme contre son prochain » (339).
[44] Russell estime que le monde est composé de faits, et que le langage sert à statuer sur eux : « Le rôle essentiel d’un langage est d’affirmer ou de nier des faits » (1961, p .9). Le sens des propositions dépend de leur adéquation à ces faits. Mais les faits eux-mêmes ne peuvent être définis que par cette propriété : « Le monde consiste en faits : les faits ne peuvent, à strictement parler, être définis, mais nous pouvons expliquer ce que nous entendons en disant que les faits est ce qui rend les propositions vraies ou fausses » (p. 14). La circularité non critique du propos éclate.
[45]On sait que la tripartition syntaxe / sémantique / pragmatique a été proposée par Morris et Carnap dans l’Encyclopædia of Unified Science, manifeste du positivime logique, qui reprenait explicitement le programme réductionniste du Cercle de Vienne.
[46] Notamment chez Quirinus Kühlmann, Gottfried Arnold, Johannes Scheffler. Ce dernier utilise presque exclusivement le distique épigrammatique, qui prescrit ou appelle le paradoxe. Il écrit par exemple : « Ich muss noch über Gott in eine wüste ziehn » (Le pélerin chérubinique, I, 7 ; « Je dois encore monter plus haut que Dieu, dans un désert »).
[47] Nous propageons sans illusions la doxa contemporaine sur les sophistes, que l’on héroïse à présent comme on les diabolisait naguère. Faute de sources fiables et d’un corpus, ils resteront une légende ; mais elle a sa beauté.
BIBLIOGRAPHIE
Angelus Silesius (1946) Pélerin chérubinique, Paris, Aubier.
Arnaud, C. (1988) Chamfort, Paris, Laffont.
Camus, A. (1944) Préface à Chamfort : Maximes et anecdotes, Monaco, Editions du Rocher.
Chamfort (1795) Œuvres, Paris, Imprimerie des sciences et des arts, 4 vol. [éditées et introduites par Ginguené].
Chamfort (1968) Maximes et pensées, caractères et anecdotes, Paris, Garnier-Flammarion [éd. Jean Dagen].
Douay, F. (1987) La contre-analogie, Groupe de travail sur l’analogie, Recueil de textes n° 10, pp. 4-61
Douay, F. et alii (1993) Les figures de rhétorique — Réévaluation des priorités, Verbum, XIV, 1-3, pp. 183-195.
Dousset E. (1974) Sébastien-Roch-Nicolas Chamfort et son temps, Clermont, Mont-Louis.
Molinié, G. (1987) Eléments de stylistique française, Paris, PUF.
Montandon, A. (1993) Les formes brèves, Paris, Hachette.
Pagnini, A. (1990) Una raccolta di proverbi yemeniti : saggio di descrizione formale, Annali di Ca' Foscari, XXIX, 3, pp. 55-76.
Rastier, F. (1971) Les niveaux d'ambiguïté des structures narratives, Semiotica, III, 4, pp. 289-342.
Rastier, F. (1987) Sémantique interprétative, Paris, PUF.
Rastier, F. (1989) Sens et textualité. Paris, Hachette.
Rastier, F. (1991) Sémantique et recherches cognitives. Paris, PUF.
Rastier, F. (1994 ) Tropes et sémantique linguistique. Langue française , 101, pp. 80-101.
Rastier, F., Cavazza, M. , Abeillé, A.. (1994 ) Sémantique pour l’analyse, Paris, Masson.
Riffaterre, M. (1992) Paradoxes décadents, in Shaw, M. et Cornilliat, F. (éds.) Rhétoriques fin de siècle, pp. 220-233.
Rivarol, A. de (1880) Maximes et pensées, anecdotes et bons mots, in Œuvres choisies, Paris, Librairie des bibliophiles, t. I.
Russell, B. (1961) Préface à Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard.
Schlegel, F. (1978) Fragments critiques, in Lacoue-Labarthe, Ph. et Nancy, J.-L., éds. L’absolu littéraire, Paris, Seuil, pp. 81-98.
Teppe, J. (1950) Chamfort, sa vie, son œuvre, sa pensée, Paris, Clairac.
Watzlawick, P. et al. (1972) Une logique de la communication, Paris, Seuil.
Vous pouvez adresser vos commentaires et suggestions à : Lpe2@ext.jussieu.fr